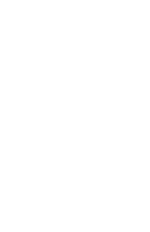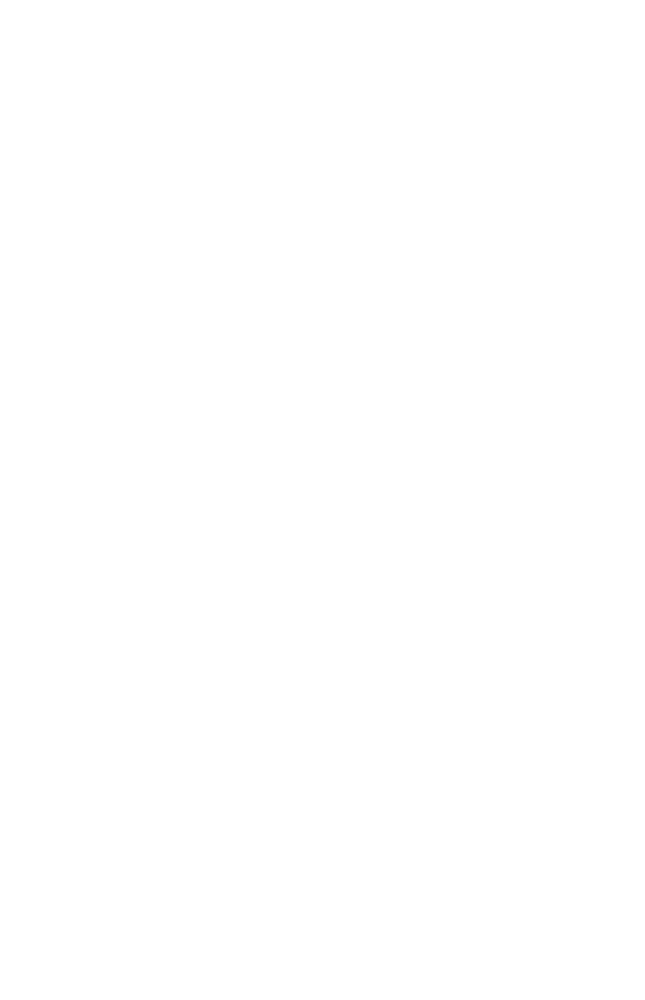D’où vient la culture du surf ?
A partir des années après-guerre, les ados s’identifient aux stars de l’époque, un mouvement lancé par Elvis Presley. Par la suite, dans les années 60, les Beatles révolutionnent la teen culture accompagnés par les Stones et les Beach boys qui chantonnent le fameux “Surfin USA”. C’est donc à partir de ce mouvement culturel auquel se rattache la pratique du surf. Peu pratique à l’époque, excepté sur la célèbre île d’Hawaï, le surf connaît un essor monumental qui le pousse en avant auprès de la jeunesse californienne.
Les experts relient aussi la musique des années 60 à la construction de la culture surf. L’amour du soleil et de la joie de vivre deviennent des piliers de ce mode de vie.
La démocratisation du surf
Dans les médias
Le milieu des années 80′ permet un retour du surf dans les médias. Tandis que des compétitions se développent, des champions connaissent le succès et la renommée. L’envie de balayer les clichés des hippies consommateurs de drogue est belle et bien présente. Le surf devient devient un sport pop. La représentation de cette pratique devient plus sérieuse et plus encadrée grâce à l’arrivée de Kelly Slater (surfeur américain champion du monde, a joué dans “Alerte à Malibu”).
Et Kelly ne sera pas le seul à participer au développement du surf sur grand écran. En 1991, le film “Point Break” nous plonge au coeur des surfeurs de Los Angeles. Ainsi, cette démocratisation du surf ne destine plus cette pratique uniquement aux amateurs. Ce n’est plus seulement l’effort mais aussi la culture qui est associée à ce sport.
De ces deux premiers essais au cinéma, naissent de nombreux autres projets à Hollywood. Par cet avènement de la pop culture, le surf attise la convoitise de nombreux ado dans le monde. Une nouvelle génération de surfeurs se met en place, la curiosité d’un nouveau public est piquée.
En France, on parle du sujet sur le ton de la rigolade avec “Brice de Nice” en 2005. Avec plus de sérieux, le contient européen s’essaye déjà à la glisse depuis depuis les années 1980 de par l’influence de la culture du skate. Les années 2000 marquent un retour à la cool et au chill.
Par la suite, certains magazines développent et participent à la retranscription de la culture du surf auprès du grand public.
La mode “surf“
De par cet essor, nombreux sont les entrepreneurs qui vont s’intéresser à la culture du surf. Après l’élan du cinéma, on remarque l’apparition de marques vestimentaires reprenant les codes des vêtements techniques. Le succès est là, avec une clientèle, pas forcément pratiquante, qui accourt. Parmi ces marques, on retrouve Quiksilver (marque australienne), Oxbow (marque française) et O’Neill (marque américaine). Les marques sponsorisent les sportifs et développent la création d’évènements et de compétitions internationales. Les marques de textiles spécialistes de la mode surf se lancent les unes après les autres. L’objectif est commun : vendre la surf coolitude.
La nouvelle ère du surf
Après les années 2000, le constat commercial est bien là. Le surf a réussi à drainer et créer une économie textile et touristique à lui tout seul. Les marques ont bien compris l’intérêt financier grandissant du créneau qu’est la culture surf.
Investissements, sponsoring et publicités en masse, c’est le début d’une nouvelle ère pour cette pratique sportive. L’image du surf change. Le temps des consommations illégales est révolue. La culture surf se rapproche du bohème et d’un style de vie simple et modeste hors des sentiers battus via l’utilisation de van. Le paradoxe de l’industrie du surf est donc bien présent.
Après 50 ans de passages à des stades différents, la culture du surf revient aux bases de son fondement.